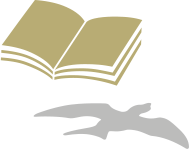Henriot Emile
Mythologie légère
Article number 10123957
On n’apprend plus la mythologie dans les collèges. C’est dommage. Aujourd’hui la jeunesse ignore ces contes charmants qui faisaient plaisir à nos pères et peuplaient pour eux les cieux vides, d’images délicieuses et de symboles pleins de sens. J’ai toujours rêvé pour ma part d’écrire une mythologie, et je ne sais ce qui m’a retenu : la difficulté, ou le scrupule. La difficulté est grande, car d’abord il faudrait choisir, très souvent, entre des traditions diverses qui ne concordent pas, et l’origine des dieux innombrables est embrouillée. Le scrupule vient d’une autre cause, et tient du respect. Cette vie des dieux est si gaie qu’il me paraît impossible d’en traiter d’une manière grave, et l’écueil serait de tomber, à leur égard, dans une familiarité déplacée. Il y faudrait le tact et le génie d’Ovide. D’autre part, Dassoucy, Saint-Amant, La Fontaine ont trop bien exploité cette veine pour qu’il soit raisonnable de penser jamais faire mieux qu’ils n’ont fait ; et depuis Meilhac et Halévy on ne saurait parler avec liberté d’Hélène, de Mercure et d’Orphée. Je ne vois que Jean Giraudoux pour avoir, dans Amphitryon et La Guerre de Troie n’aura pas lieu, touché à ces mythes en les renouvelant. Mais ce n’est que par incidence. Un autre danger serait de donner dans la solennité avec laquelle d’ordinaire les mythologues cherchent à s’expliquer ces fables. Elles sont plus humaines que divines. Et s’il est exact que les dieux ont fait l’homme à leur image et que l’homme le leur ait bien rendu, cette réciproque est vraie surtout à l’égard de cette mythologie païenne où la naïveté des premiers âges méditerranéens s’est plu à peupler l’invisible de cette multitude de dieux et de déesses à figure humaine, qui ne se différenciaient des mortels que par la puissance et l’activité. Je ne sais pas trop le secours surnaturel qu’un contemporain de Virgile, pieux aux autels de Jupiter, pouvait raisonnablement attendre de ce démiurge et des autres olympiens. C’étaient des dieux de bon plaisir et sans moralité aucune. Leur histoire n’élève pas les cœurs et n’inspire pas le désir du bien. Elle ne touche l’âme que rarement, mais elle émerveille l’imagination, et c’est pour cela qu’elle est encore si plaisante. Il faut croire que les anciens, à la fois poètes et réalistes, avaient l’esprit assez léger et sans grand fond religieux, à voir comment ils se contentaient de rendre un culte purement formaliste aux puissances cachées qui mènent le monde, pourvu que ce fût en pompe bien ordonnée et en cérémonies fastueuses. La contemplation de Vishnou et la prière devant Bouddha témoignent de tout autres besoins dans une âme croyante et de leur obédience. Montesquieu pour nous a très exactement fait le point en spécifiant qu’il aurait très bien rempli la religion des païens, où il n’y avait qu’à fléchir les genoux devant des idoles. Mais que ces dieux grecs sont donc jolis à voir, et divertissants dans leurs aventures ! On a eu raison de le dire : la lecture en est plus attachante que celle d’aucun roman, et l’on n’en sait pas de plus varié, de mieux agencé, que celui de ces amours, de ces brouilles, de ces intrigues et de leurs dénouements, qui font encore aujourd’hui du vieil Olympe un si prestigieux théâtre de comédie, de drame et de fantaisie poétique. Quel est donc le poète qui a inventé tout ce fabuleux personnel ? Qu’il soit issu tout entier de l’imagination populaire, cela est bien difficile à croire. Dans son besoin d’adorer et de conjurer l’invisible, et de personnifier ses craintes, l’imagination populaire a pu créer le monstre initial et tout-puissant auquel elle a dressé des temples. La broderie qui l’a embelli par la suite est d’une qualité trop esthétique et trop littéraire pour n’avoir pas été l’œuvre d’un conteur, expert à l’intrigue et à la mise en scène. Au-delà des temps, comment ne pas supposer l’existence de ce lointain poète de génie qui, le premier, aura vu les dieux, dans son esprit, et assemblé dans une première théogonie les traits encore informes et épars de leur légende ?... Quel était-il, celui qui le premier a conçu Vénus dans sa conque, et sous la figure exquise de Psyché symbolisé le combat éternel de l’âme et du désir ? Et à toutes les forces naturelles, l’air, le vent, les bois, la source, les saisons, qui a donné leur symbole vivant ? Qui, sinon la raison, contente et charme en nous les puissances éternelles du rêve ?... Les dieux sont ce que nous les faisons ; tout mythe a sa nécessité, ne fût-ce que pour simplifier le discours. C’est pourquoi nous avons grand tort d’avoir oublié la mythologie et de négliger d’en instruire nos enfants. Sans elle que peuvent-ils comprendre aux classiques, aux figures sculptées et peintes des musées ? Elle continue aussi à commander par son vocabulaire tant d’aspects du monde physique où nous vivons. Pourquoi la Grande Ourse, dans le ciel ? C’est Callisto, métamorphosée par Jupiter une fois qu’il eut assez d’elle. Et si ce soir la lune est voilée, qui peut se souvenir parmi nous que c’est l’effet de la pudeur de Diane quand elle reçoit Endymion ?... Songez-y, au prochain croissant.
Condition
Used - Good
Language
French
Article type
Book - Paperback
Year
1957
Publisher
Paris
pp. 200 / Libraire Arthème Fayard, band wat verkleurd / discolouration, Les quarante